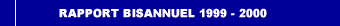
Seconde partie : FONCTIONNEMENT
DU CENTRE
A. Les Membres du Centre
1. Présentation des membres
Le mode de désignation des membres par la Chambre,
soit directement, soit sur présentation du Conseil des Ministres,
en tenant compte de la parité linguistique, offre au départ
une garantie de pluralisme qui engage le Centre, a priori, dans une
démarche indépendante, et lui donne un label démocratique
inattaquable vis-à-vis de ceux qui contestent, par principe
ou par crainte, sa création.
La pratique montre que cette garantie démocratique était
nécessaire face aux préjugés, tant en Belgique
qu'à l'étranger.
Les membres ont été désignés
sur base de leur connaissance, leur expérience et leur intérêt
pour la problématique des mouvements sectaires nuisibles. Le
Ministre de la Justice actuel, M. Verwilghen, présidait alors
la commission chargée de l'audition des candidats avant leur
désignation par la Chambre des représentants.
La plupart d'entre eux avaient préalablement,
d'une manière ou d'une autre, été associés
au travail de la Commission d'enquête parlementaire ou sont
issus du monde associatif intéressé par la dite problématique.
Le président, M. Adelbert DENAUX, et le président
suppléant, M. Henri de CORDES, ont été désignés
par la Chambre dans la liste des Membres.
2. Démission de Membres :
Mmes Dury, Cornille, MM. Baeselen et Liagre
-Membre désigné par la Chambre des représentants
:
le 22.12.00 : M. Xavier BAESELEN, membre suppléant,
qui entame un mandat échevinal
Membres présentés par le Conseil des
Ministres :
-le 10.09.99 : Mme Raymonde DURY, membre suppléant
-le 15.05.00 : Mme Catherine CORNILLE, membre suppléant, qui
part vivre à l'étranger
-le 12.03.01 : M. Rodolphe LIAGRE, membre suppléant, qui part
vivre à l'étranger
3. Renouvellement
Les membres du Centre sont attachés à
l'équilibre qui a présidé à sa composition
initiale qu'ils considèrent comme un garant de l'indépendance
voulue par la Loi.
4. Problème des indemnisations
Non-indemnisation des suppléants en séance
quand l'effectif est présent :
Le ministère de la Justice a fait savoir en
août 1999 que, pour l'Inspection des finances, un membre suppléant
présent à une réunion ne peut toucher d'indemnité
si le membre effectif est également présent. La pratique
indique que certains suppléants participent régulièrement
aux réunions alors même que le membre effectif est présent,
et ce sans donc recevoir les jetons de présence prévus
par l'article 2 de l'Arrêté royal du 13 juin 1999 fixant
les modalités de l'indemnisation du président et des
membres du Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires
nuisibles. Contact pris avec l'inspecteur des finances, il n'apparaît
pas que le système puisse changer, malgré le fait que
des Membres suppléants en aient fait la remarque, soulignant
que les suppléants, pour être au fait des dossiers devaient
bien être présents à des réunions du Centre.
Vous trouverez ci dessous la liste des Membres (colonnes
de gauche)
et celle de leurs suppléants en vis-à-vis (colonne de
droite).
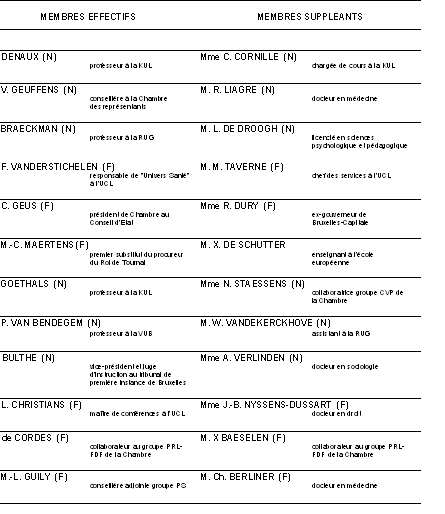
B. Le Secrétariat du Centre
1. Mode de désignation
Procédure d'avis préalable : ce principe,
exigé par la loi pour le recrutement du personnel, est primordial
pour protéger l'indépendance du Centre. Il est défendu
par tous les membres. Le personnel engagé de niveau un a été
entendu par les Membres après une première sélection
des candidatures sur base des dossiers " papier ". Ils ont
reçu l'avis préalable avant transmission des dossiers
de recrutement au Ministère de la Justice.
Le Centre, puisque récemment créé,
a dû préalablement consacrer une part importante de ses
activités à la sélection et au recrutement du
personnel. Le principal, sinon le bibliothécaire, est à
présent effectué.
Présentation générale : Des premiers
contacts avec la coordination du personnel au ministère de
la Justice, il ressortait que le Centre pouvait disposer alors d'un
conseiller, six ou sept diplômés de niveau 1, un(e) assistant(e)
de direction, 2 commis, un employé de niveau 3 et une personne
pour l'entretien. En fait, 7 postes universitaires étaient
prévus au cadre budgétaire pour l'année 2000.
La réalité de la gestion du département de la
Justice a fait que des emplois vacants au cadre, peu clairement fixés,
ont été en fait attribués à un ou des
service(s) de l'administration centrale du département.
2. Directeur du Centre
Après avis favorable préalable le 28
juin 1999 sur base de ses compétences, il est entré
immédiatement en fonctions. Il provient du cadre de la Justice
comme ex-conseiller chef d'un service d'études à l'administration
centrale. Il dirige le secrétariat sous la responsabilité
directe du Président (non de l'administration).
3. Membres du secrétariat
Outre le directeur, le profil des niveaux 1 était
prévu par les membres comme indiqué ci-après
: juriste, criminologue, psychologue, sociologue, historien, théologien,
bibliothécaire / documentaliste (réunion du 28 juin
1999).
Quoiqu'il en soit, il était estimé prématuré
de définir précisément, a priori, les besoins
d'une manière trop figée, puisqu'il faudrait les évaluer
" sur le terrain " même pour les différentes
fonctions nécessaires.
Le secrétariat est organisé de la façon
suivante :
- directeur ;
- un niveau 2 pour le secrétariat stricto sensu, finalisation
des commandes de livres et gestion de la documentation ;
- un service d'études : les universitaires, y compris le juriste,
avec l'appoint du niveau 2. Les dossiers sont répartis au sein
de l'équipe de manière telle qu'il y ait un " maître
du dossier " pour chaque sujet (organisation ou thème).
Une réunion hebdomadaire règle les problèmes
de coordination et de complémentarité ;
- le service juridique : le juriste existant, qui devrait être
assisté d'un second juriste ;
- la bibliothèque et la documentation ouverte (au public) :
un des niveaux 1 en est plus particulièrement chargé
avec l'assistant administratif, et le niveau 4. L'accueil du public
est faite par les différents membres du personnel, selon les
cas et les disponibilités.
- niveau universitaire :
- 1 juriste :
Conseiller adjoint provenant d'un service d'études
juridique du Ministère de la Justice, après avis favorable
préalable.
Outre le travail d'analyse au sein du service d'études, il
est en charge de l'accueil du public pour l'informer de ses droits
et obligations.
- 4 universitaires contractuels pour le service d'études
:
- une psychologue (agrégée) qui a fait un mémoire
sur les techniques de manipulations mentales des sectes (dites) dangereuses,
formée à l'écoute, expert auprès de parquets
(jusqu'à son engagement au Centre) (pour information : le Centre
n'est pas compétent pour l'accueil psychologique);
- une sociologue qui a fait un mémoire sur la motivation à
participer à un " nouveau mouvement religieux ";
- un criminologue, agrégé et titulaire d'un baccalauréat
en théologie;
- une politologue (relations internationales) qui a fait un mémoire
sur les milices aux Etats-Unis.
- 1 universitaire bibliothécaire / documentaliste
:
Place attribuée, mais impossibilité
actuelle d'engager en raison de la difficulté, pour l'intéressée,
de pouvoir accepter un poste (de contractuel) qui exige de l'expérience
alors que le traitement n'est pas attractif précisément
pour un candidat hautement spécialisé et qui possède
cette expérience, l'ancienneté n'étant pas prise
en compte.
L'absence de bibliothécaire suffisamment spécialisée(e)
ou expérimenté(e) ne permet pas de remplir au mieux
les missions légales imparties au Centre. Ce problème
constitue donc, à ses yeux, une priorité à résoudre.
- niveaux 2 et 4 :
- un assistant administratif issu du Ministère
de la Justice, pour le secrétariat stricto sensu, principalement
- un ouvrier contractuel qui travaille principalement au classement
des pièces.
- besoins complémentaires : après l'engagement
du bibliothécaire :
+ un juriste néerlandophone
+ un assistant documentaliste / bibliothécaire
+ 2 universitaires pour le service d'études : le nombre de
demandes d'information effectuées par le public occupe le principal
du temps du service d'études qui, par ce fait, ne dispose pas
de suffisamment de temps pour se consacrer à d'autres travaux
thématiques, plus généraux.
4. Problème du cadre : cf. indépendance
du Centre
- le statut des contractuels (temporaires) implique
qu'après acquisition d'expertise, le Centre risque de perdre
du personnel hautement qualifié ; l'idéal serait de
pouvoir stabiliser le personnel le plus adéquat. En outre,
la différence statutaire pourrait entraîner, à
terme, une moins grande motivation. Pour mémoire, les engagements
de contractuels impliquent un contrat annuel à renouveler.
- l'absence de cadre organique implique un risque
pour la bonne continuité d'un service voulu par la loi et pour
lequel la mise à disposition du personnel signifie par la même
occasion que celui-ci pourrait être mis, le cas échéant,
à disposition d'un service du ministère de la Justice
(ce qui, par ailleurs, n'a pas été le cas jusqu'à
présent). L'indépendance du Centre voudrait que soit
établi ce point.
- il serait nécessaire que le Centre, son secrétariat,
dispose d'un cadre permanent qui garantirait l'indépendance
et la continuité de son travail : son directeur (au rang de
conseiller), les universitaires (conseillers adjoints), les niveaux
deux, etc..
Problèmes logistiques :
- indépendamment de la volonté du Centre, les problèmes
informatiques sont longs à être réglés
et la mise en œuvre n'est pas encore suffisante (internet, e-mails,
data base, etc..). L'aspect de la protection des données est
également un point primordial qui nécessite un développement
particulier, y compris la sécurité physique du matériel
et de ses accès.
5. Implantation du Centre et de ses services
a. La loi prévoit que le Centre aura son siège
dans la Région de Bruxelles-Capitale et qu'il dispose d'un
secrétariat dont le personnel est mis à disposition
par le Ministre de la Justice, après avoir recueilli l'avis
préalable du Centre.
Le personnel est mis sous l'autorité directe du président
du Centre.
Le Secrétariat du Centre a été
placé sous la direction d'un directeur, M. E. Brasseur, issu
de l'administration de la Justice, et après avis préalable
des Membres.
b. Dès le mois d'août 1999, choix est
fait par les administrations de la Justice et la Régie des
bâtiments d'un immeuble sis rue Berkendael, à Uccle,
pour recevoir le Centre. Provisoirement, en attendant la mise à
disposition, le siège est installé rue Guimard à
Bruxelles, dans 2 locaux situés dans un immeuble de la Police
judiciaire. Le Berkendael devait être disponible à la
fin de l'année et ses plans d'aménagement ont été
réalisés sur base des demandes spécifiques du
Centre. In fine, la date d'installation a été reportée
de mois en mois jusqu'à la décision de loger le service
au n° 139 de la rue Haute, à 1000 Bruxelles, qui a l'avantage
important d'être d'un accès aisé pour le public,
situé prés de la gare centrale. Le résultat concret
de cette attente a été l'incapacité à
recevoir le personnel nécessaire à l'accomplissement
de ses missions, et ce jusqu'au mois d'août 2000. Le principal
du mobilier a été livré fin août 2000 et
le mobilier de bibliothèque en mars 2001.
c. Partage des locaux :
Les services des administrations compétentes ont estimé
que le Centre disposait d'une superficie trop importante pour ses
besoins actuels et le Centre a dû accepter de partager ses locaux
avec un autre service. Depuis mars 2001, décision a été
prise d'installer la Commission de conciliation des litiges de la
Construction. Compte tenu de la mission d'information orientée
principalement vers le grand public, il est primordial d'assurer une
stabilité dans l'implantation de la bibliothèque dans
ce lieu où une possibilité d'extension existe. Un changement
de lieu poserait au Centre des difficultés d'accès pour
le public et d'organisation interne rendant l'exécution des
missions plus difficiles.

HAUT Troisième
Partie Sommaire